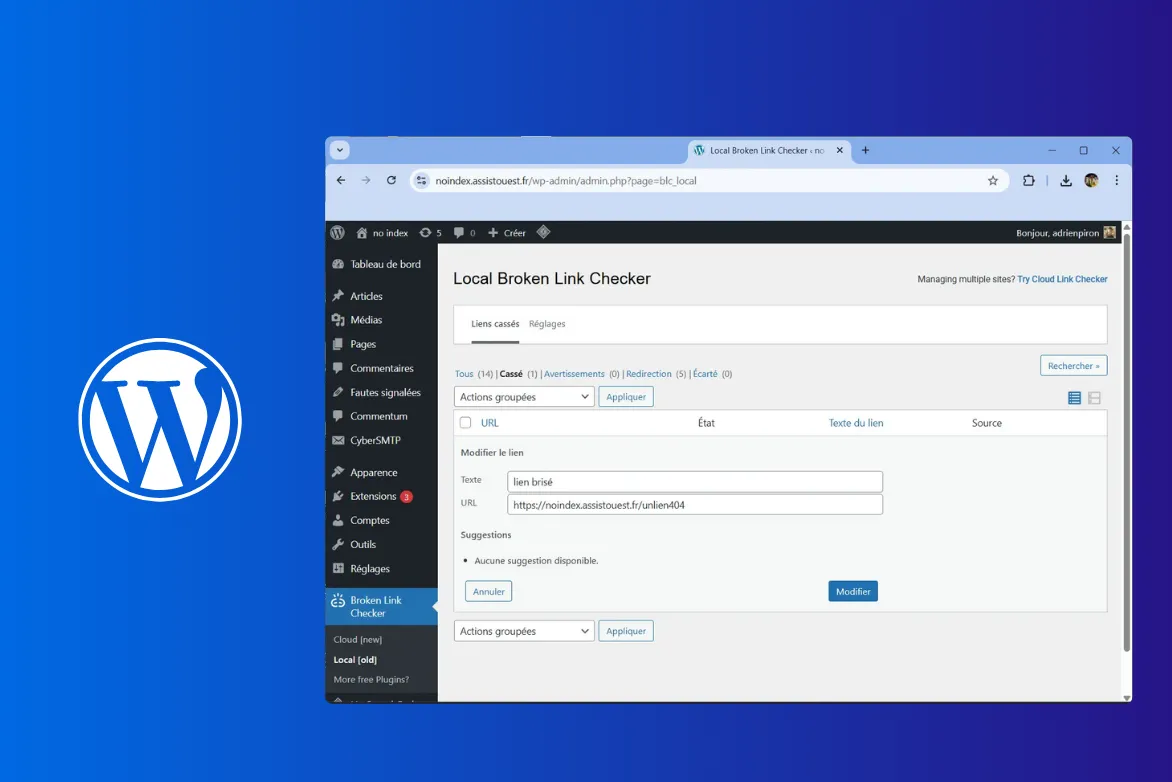En France, près d’un internaute sur trois utilise un bloqueur de publicités. Selon les dernières études, ils seraient entre 31 et 36 % à filtrer bannières, vidéos sponsorisées et annonces contextuelles. Un chiffre qui menace directement le modèle économique de nombreux sites et interroge sur l’avenir du web gratuit. D’où vient cette tendance ? Qui sont les utilisateurs d’adblock ? Et comment les éditeurs peuvent-ils s’adapter ?
Combien de Français utilisent un bloqueur de publicités ?
Les dernières études confirment qu’en 2024 environ 31 % des internautes français utilisent un bloqueur de publicités. Ce chiffre provient des données de GWI et DataReportal qui s’appuient sur de larges panels représentatifs des utilisateurs de 16 à 64 ans.
En remontant dans le temps, une étude IAB / Ipsos réalisée en 2016 révélait un taux d’adoption de 36 % soit plus d’un tiers des internautes. Cette proportion marquait alors un bond de 6 points par rapport au début de la même année (30 %).
| Année | Source | Taux d’adoption |
|---|---|---|
| 2024 | GWI / DataReportal | 31 % |
| 2016 | IAB / Ipsos | 36 % |
Ces statistiques proviennent principalement d’enquêtes en ligne menées sur des panels d’internautes. Les participants indiquent s’ils utilisent ou non un adblock, même si la proportion exacte peut varier selon la méthode de mesure, toutes les études concordent entre un tiers et un peu plus d’un tiers des internautes français utilisent un bloqueur de publicités.
Pourquoi les internautes utilisent un bloqueur de publicités ?
La première motivation évoquée par les utilisateurs est l’excès de publicités intrusives. Entre les bannières animées, les pop-ups agressifs et les vidéos qui se lancent automatiquement, l’expérience de navigation peut vite devenir pénible. Les bloqueurs de publicité répondent à ce problème en supprimant ces éléments perturbateurs. Chaque annonce publicitaire ajoute son lot de scripts, d’images lourdes et de trackers, ce qui alourdit considérablement les pages web. En bloquant ces éléments, les internautes gagnent en rapidité d’affichage, économisent de la bande passante et réduisent la consommation de données, un point particulièrement apprécié sur les forfaits mobiles limités.
La question de la confidentialité pèse également dans la balance. Les régies publicitaires collectent des données massives sur les habitudes de navigation à l’insu des utilisateurs. Les bloqueurs agissent alors comme un bouclier contre ce pistage, empêchent le chargement de cookies tiers, la collecte d’empreintes numériques et l’exécution de scripts invisibles.
Le profil type de l’utilisateur de bloqueur de publicités est généralement un internaute âgé de 18 à 34 ans, familier des outils numériques et plus sensible aux enjeux liés à la vie privée en ligne. On observe encore une légère majorité masculine, mais cet écart se réduit avec la popularisation des bloqueurs sur mobile. Historiquement concentrée sur le desktop grâce aux extensions de navigateurs, cette pratique s’est largement répandue sur smartphone, portée par des navigateurs intégrant nativement un bloqueur et par les options offertes par iOS et Android. Aujourd’hui, l’usage se répartit presque équitablement entre ordinateurs et mobiles.
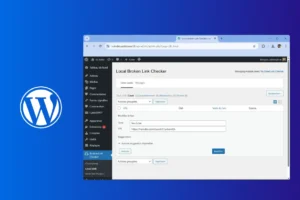
Les conséquences pour les éditeurs de sites
La généralisation des bloqueurs de publicités a un impact direct sur les revenus des éditeurs en ligne. Les estimations varient selon les études mais la perte se chiffre en milliards d’euros à l’échelle mondiale chaque année. En France, les régies et médias parlent d’un manque à gagner pouvant représenter 20 à 40 % de leurs revenus publicitaires, un chiffre qui peut grimper encore plus haut pour les sites fortement dépendants de la monétisation. Pour les médias en ligne, les blogs et les créateurs sur YouTube, cette érosion des revenus fragilise le modèle économique et réduit la capacité à produire du contenu.
Face à cette situation, les éditeurs ont dû s’adapter. Certains affichent des messages d’appel au soutien lorsqu’un bloqueur est détecté pour incitant les visiteurs à désactiver leur outil ou à effectuer un don. D’autres misent sur des formules d’abonnement qui donne accès à des contenus premium sans publicité. Les contenus sponsorisés et le marketing d’influence se sont également imposés comme des alternatives pour financer la production sans passer par les régies classiques. Certaines plateformes adoptent également des formats plus légers et moins intrusifs comme le programme Acceptable Ads qui autorise uniquement des annonces respectant des critères stricts de discrétion et de non-nuisance pour l’utilisateur.
Les échecs d’Acceptable Ads et des dons
Pour limiter l’impact des bloqueurs de publicité, certains éditeurs misent sur Acceptable Ads, les appels aux dons ou les abonnements sans publicité afin d’offrir une expérience plus respectueuse tout en maintenant un minimum de revenus.
Mais dans les faits, ces solutions peinent à convaincre. La plupart des utilisateurs d’adblock refusent toute publicité même discrète et rendent Acceptable Ads largement inefficace. Les dons ne mobilisent qu’une fraction infime des visiteurs (- de1%) et les abonnements exigent une audience engagée que peu de sites peuvent atteindre.
Ces alternatives ne suffisent pas à compenser les pertes. Les éditeurs doivent donc repenser leur modèle économique et recourir à des stratégies plus diversifiées ou à des systèmes anti-adblock avancés.
Les bloqueurs de pub poussent les créateurs vers l’affiliation
Le web gratuit reposait sur un échange du contenu accessible à tous financé par la publicité. Mais avec la montée en puissance des bloqueurs, ce modèle est en train de disparaître. Les solutions alternatives (Acceptable Ads, dons, abonnements) ne parviennent pas à compenser la perte de revenus et laissent l’affiliation comme unique planche de salut pour beaucoup de créateurs.
Ce basculement entraîne un risque réel d’un web de plus en plus orienté vers la promotion commerciale, où les créateurs publient avant tout pour générer des commissions. L’information devient alors biaisée par l’objectif de vendre au détriment de l’indépendance éditoriale et de la diversité des contenus.
Sans un modèle plus équilibré, nous pourrions passer d’un internet libre et pluraliste à un écosystème où la valeur d’un article se mesure moins à sa qualité qu’à son potentiel de conversion.